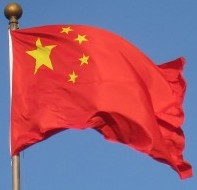 La présence de la Chine en Afrique est un sujet qui divise. Certains y voient un bienfait, d’autres une menace. De son côté, Pékin se défend de toute mauvaise intention et rappelle que son implantation sur le continent est bénéfique, tant pour la Chine que pour l’Afrique. Cependant, force est de constater que la présence chinoise en Afrique s’accompagne généralement de conséquences plutôt néfastes (tensions sociales, corruption, négligence environnementale, etc.).
La présence de la Chine en Afrique est un sujet qui divise. Certains y voient un bienfait, d’autres une menace. De son côté, Pékin se défend de toute mauvaise intention et rappelle que son implantation sur le continent est bénéfique, tant pour la Chine que pour l’Afrique. Cependant, force est de constater que la présence chinoise en Afrique s’accompagne généralement de conséquences plutôt néfastes (tensions sociales, corruption, négligence environnementale, etc.).
Pour la Chine : loin des yeux, très loin du cœur…
Le géant chinois témoigne d’un certain dédain pour les pays qui alimentent sa croissance. Et c’est en Afrique que la politique du gouvernement chinois fait le plus de dégâts, tant le continent est vulnérable dans sa quête d’investisseurs pour financer son développement. D’une manière générale, la Chine semble plus intéressée par les dirigeants africains que par le reste de la population. L’objectif est avant tout de sécuriser le cadre des affaires — ce que Pékin appelle sa politique de « non-interférence ». Cela engendre des situations ahurissantes comme en Angola, où l’exploitation du pétrole par Pékin représente une large part des 69 milliards de dollars de budget annuel de l’État, mais où 70 % de la population vit encore avec moins de deux dollars par jour.
Concernant ses partenaires africains, la Chine ne s’est jamais montrée très regardante. En effet, Pékin n’hésite pas à tendre la main à des régimes autoritaires, dont les actions ont été vivement condamnées par la communauté internationale. Ainsi, elle s’est rapprochée de plusieurs pays faisant l’objet d’un embargo de l’ONU, comme le Soudan ou encore le Zimbabwe. En ce qui concerne le premier, la Chine y a vendu pour 100 millions de dollars d’armes et d’avions de guerre en 2012, le tout au mépris des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui pesaient sur le régime. Pour ce qui est du second, les expropriations violentes de fermiers blancs, autorisées et même encouragées par le président Robert Mugabe, n’ont pas empêché Pékin d’y négocier des accords bilatéraux concernant les télécoms et l’énergie.
Et ce n’est malheureusement pas tout. En Afrique, la présence chinoise s’accompagne également d’un phénomène de corruption, que l’actualité est venue une nouvelle fois souligner. Mahmoud Thiam, ancien ministre des Mines Guinéen a été arrêté à New York le 13 décembre 2016. Il est accusé d’avoir touché, en 2009, des pots-de-vin à hauteur de 8,5 millions de dollars de la part de conglomérats chinois — des fonds qu’il aurait ensuite tenté de blanchir aux États-Unis. L’utilisation de la corruption semble être une habitude pour les entreprises chinoises implantées en Afrique : pour 61 % des répondants à l’étude du Ethics Institute of South Africa, intitulée « Africans’ perception of Chinese Business in Africa », celles-ci en usent régulièrement.
Des populations locales qui saturent…
Ces abus sont le fruit direct de la politique de non-ingérence du pays — qui revient à fermer les yeux sur ce qui se passe en dehors de ses frontières. Dans ces conditions, c’est sans surprise que l’étude nous apprend que les africains, ont « une mauvaise image » des entreprises chinoises sur leur continent. La corruption n’est pas l’unique raison de ce rejet. L’implantation chinoise aurait dû être synonyme de création d’emplois et d’embauches, mais ce ne fut pas le cas. Du moins pour les Africains. Les entreprises chinoises ont en effet préféré ramener leur propre main-d’œuvre sur place, de quoi attiser encore un peu plus les tensions.
Ce désintéressement pour les populations locales crée chez elles de fortes frustrations, celles-ci étant reléguées au rang de simple spectateur de la croissance de leur pays. Le phénomène a pris une telle ampleur qu’il a causé des émeutes et des violences contre les travailleurs chinois au Kenya, en Angola, au Cameroun, ou encore en Algérie. Les récents enlèvements d’ingénieurs chinois au Nigéria témoignent quant à eux d’une autre réalité : les Africains embauchés au sein d’entreprises chinoises connaissent des conditions de travail déplorables (absence de syndicat, droit du travail bafoué, pas de salaire minimum, etc.). Le mode de vie découlant de la présence chinoise en Afrique n’est manifestement pas idyllique pour la population africaine qui semble arriver à saturation.
Aux yeux de la Chine, l’Afrique reste cantonnée presque exclusivement à un rôle de fournisseur de matières premières. Les chiffres le confirment : deux tiers des exportations africaines à destination de la Chine sont des ressources naturelles. La puissance chinoise est en demande constante de matières premières. Et les tensions récurrentes au Moyen-Orient corrélées à l’épuisement des ressources de leurs fournisseurs historiques ont poussé les dirigeants chinois à trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. C’est alors qu’ils se sont tournés vers l’Afrique. Mais au grand dam du continent, ils semblent afficher la même négligence sociale et environnementale que par le passée.
L’exemple de la Bauxite, élément clé de la production d’aluminium et très prisée par le géant chinois, reflète bien cette négligence. La puissance chinoise s’était à l’origine orientée vers le Vietnam, l’Indonésie et la Malaisie pour extraire le précieux minéral. Oui, mais voilà. Au bout de deux ou trois ans, ils ont décidé chacun leur tour de mettre un terme à leur partenariat avec Pékin. La raison?? Pollution, maladies, destruction… Les pratiques chinoises dans chacun de ces pays ont été dévastatrices. Aujourd’hui, les robinets asiatiques s’étant coupés, c’est en Guinée que la Chine s’approvisionne. Le terrain a changé, mais la manière de faire elle, reste malheureusement la même…
Jean Diabaté
